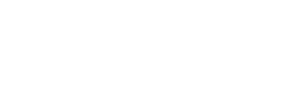Atteindre un équilibre entre la préservation de la nature et la nécessité de disposer de réseaux de transport modernes
Article vedette d’un commanditaire de l’ATC – WSP Canada Inc.
par Ben O’Hickey
La construction de nouvelles routes et de nouveaux couloirs de transport occasionne nécessairement le découpage de notre environnement naturel. Il peut s’agir de zones très sensibles telles que les tourbières et les zones humides, de terres utilisées pour la production agricole, de forêts qui captent le dioxyde de carbone ou de prairies qui servent de pâturages à diverses espèces animales.
Chaque fois qu’une nouvelle route ou une nouvelle voie ferrée est construite, elle peut avoir un impact négatif sur notre environnement.
Comment réduire cet impact au minimum? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour protéger et restaurer le milieu naturel?
Il s’agit d’abord et avant tout de s’assurer que la biodiversité est prise en compte à chaque phase du projet.
Conception du projet et choix du tracé
Les effets écologiques créés par les infrastructures linéaires entraînent une fragmentation des habitats naturels et peuvent réduire les populations de nombreuses espèces sauvages.
Historiquement, le respect de la biodiversité a été associé à des contraintes, voire à une opposition à la mise en œuvre des projets. Cependant, cette mentalité est en train de changer, compte tenu de la prise de conscience de la crise de la perte de biodiversité et des engagements pris par les maîtres d’œuvre pour protéger la biodiversité.
La prise de conscience et la compréhension de la nécessité de protéger la biodiversité commencent dès le début du processus de définition du projet. Le choix et la conception des tracés sont essentiels, car si les projets peuvent être réacheminés ou adaptés de manière à éviter complètement les incidences sur les éléments les plus précieux de la biodiversité, tels que les forêts anciennes et les zones humides, cela évite d’avoir à mettre en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation par la suite. La prise en compte de la biodiversité dès le début de l’élaboration d’un projet peut contribuer à éviter les retards et les coûts imprévus. Cette approche est conforme à la hiérarchie des mesures d’atténuation et est de plus en plus souvent adoptée à mesure que le coût des mesures d’atténuation écologique augmente.
Les maîtres d’œuvre se doivent également être en mesure de voir et analyser leur projet de deux points de vue. D’abord, si l’infrastructure est nouvelle et traverse un habitat intact, l’accent doit être mis sur la réduction de l’emprise et de l’impact, car quoi que l’on crée, ce sera pire que l’environnement intact d’avant la construction. Par ailleurs, si le projet se situe en zone urbaine, il devrait être vu comme une occasion de créer de la biodiversité dans une zone dégradée. Les trains légers (TLR) et d’autres projets non routiers peuvent présenter les meilleures possibilités à cet égard, et il est toujours utile considérer l’environnement au sens large.
Quel que soit le paysage traversé par le projet, il est essentiel d’envisager dès le départ des mesures concrètes de réduction des incidences sur la biodiversité.
Évaluation environnementale
En ce qui concerne la biodiversité, le processus d’évaluation environnementale (EE) était jusqu’à présent axé sur la mise en place de mesures d’atténuation des incidences négatives. Cependant, on assiste aujourd’hui à un changement de mentalité qui consiste à se concentrer sur la création d’un avantage global pour la biodiversité tout au long de l’élaboration du projet.
Le Biodiversity Net Gain (BNG – rehaussement net de la biodiversité), approche utilisée au Royaume-Uni, en est un exemple. Il s’agit d’un texte législatif national qui exige des promoteurs qu’ils génèrent un gain de 10 % de la biodiversité, mesuré par la quantité et la qualité de l’habitat autour de l’emprise du projet. Il devient donc d’autant plus important d’éviter les effets environnementaux entrainant pour les promoteurs l’obligation de verser des compensations.
Les méthodes utilisées pour surveiller et mesurer la biodiversité s’améliorent également, parallèlement aux exigences accrues imposées aux maîtres d’œuvre. Il est également intéressant d’envisager l’emploi d’outils numériques au cours du processus d’évaluation environnementale en raison des avantages qu’ils peuvent apporter. Il s’agit notamment de l’utilisation de la télédétection pour les données relatives à l’habitat, des caméras de surveillance automatisées pour enregistrer la faune et la flore, ou d’autres capteurs numériques. Ces outils, ainsi que d’autres, peuvent contribuer à la création d’une évaluation environnementale plus complète, qui fournit des données détaillées sur des éléments tels que les mouvements de la faune et les schémas de migration, ce qui peut faciliter la prise de décision au cours du processus d’élaboration du projet.
Consultation des parties prenantes
La sollicitation de l’engagement de la communauté pour la protection de la biodiversité est un aspect important du développement des projets de transport.
Il est nécessaire d’impliquer les communautés dans les éléments axés sur la biodiversité ainsi que dans les aspects liés au milieu bâti, en particulier les communautés autochtones qui ont une connaissance historique approfondie du territoire. La plantation d’une forêt dans le cadre du projet en est un exemple. En travaillant avec la communauté, l’équipe de projet peut confirmer que les espèces proposées sont indigènes à la région et appropriés pour la zone de plantation.
Souvent, les solutions basées sur la nature exigent le soutien de la communauté tout au long de leur durée de vie et doivent donc être approuvées par la communauté avant d’être mises en œuvre. Il existe trop d’exemples passerelles vertes et de zones humides qui ont été aménagés à grands frais, mais sans le soutien de la communauté.
L’utilisation d’une déclaration environnementale numérique est un exemple de ce qui peut être fait pour obtenir et maintenir l’engagement de la communauté dans un projet. Ces déclarations fournissent une répertoire numérique complet des plans de préservation et de restauration de la biodiversité à l’aide d’éléments visuels tels que des cartes et des esquisses d’avant-projets.
Ingénierie et construction de projets
La prise de conscience de l’importance de la biodiversité conduit aujourd’hui à passer d’éléments d’infrastructure grise à des éléments d’infrastructure verte intégrés dans les nouveaux projets de transport. Parmi les exemples les plus populaires, on peut citer les biefs, des canaux qui permettent d’éloigner les eaux pluviales de l’infrastructure tout en éliminant la pollution et les débris des routes, et les revêtements perméables, qui éliminent l’eau des routes plus rapidement que les revêtements traditionnels tout en renflouant les nappes phréatiques avoisinantes.
Il existe ensuite des solutions de plus grande envergure et plus audacieuses, qui peuvent être justifiées financièrement en fonction de la sensibilité de la biodiversité environnante. Il s’agit d’idées telles que les passerelles vertes, les passages souterrains pour la faune, les passages à poissons et les clôtures d’exclusion pour rétablir la connectivité écologique à l’échelle du paysage. Le Canada a récemment connu une augmentation de ce type de solutions, en particulier en Colombie-Britannique et en Alberta, le long des tronçons de la route Transcanadienne.
Chacune de ces solutions peut assurer la protection nécessaire de la biodiversité, en fonction de la zone dans laquelle le nouvel axe de transport est aménagé.
Exploitation et entretien
Au Royaume-Uni, le ministère de la Voirie soutient l’intégration de la biodiversité en commençant par ce qu’il appelle le « soft estate » des axes de transport, c’est-à-dire la partie perméable de l’emprise, y compris les accotements, les haies et les zones plantées.
En assurant le contrôle et le suivi rigoureux de leurs travaux, les intervenants du Ministère ont été en mesure de générer des gains de biodiversité sur l’ensemble du réseau routier. Ce résultat a été obtenu notamment grâce à la télédétectioncombinée à la vérification des résultats sur le terrain.
La façon dont l’entretien est perçu a également évolué, avec une plus grande acceptation des accotements « désordonnés », qui sont bien plus avantageux pour la biodiversité. Ces mesures s’accompagnent souvent de coûts moindres, car il suffit souvent de réduire le nombre de tontes de gazon à deux fois par an ou d’enlever la couche de terre végétale. En modifiant les habitats le long des routes, il devient possible de créer des corridors de biodiversité plutôt que les barrières paysagères actuelles.
Il est important de comprendre, depuis les premières étapes de la conception jusqu’à la mise en œuvre du programme d’entretien de l’infrastructure, qu’il n’existe pas de solution unique en matière de biodiversité pour les projets de transport. Chaque projet est unique et comporte ses propres défis liés au milieu naturel avec lequel il s’insère. Il est important de commencer par le commencement, de comprendre l’impact du projet sur l’environnement, de travailler avec la communauté pour mettre en œuvre les meilleures solutions possibles pour la protection et la restauration de la biodiversité, et de continuer à s’améliorer dans l’exploitation et l’entretien de l’actif tout au long de son cycle de vie utile.